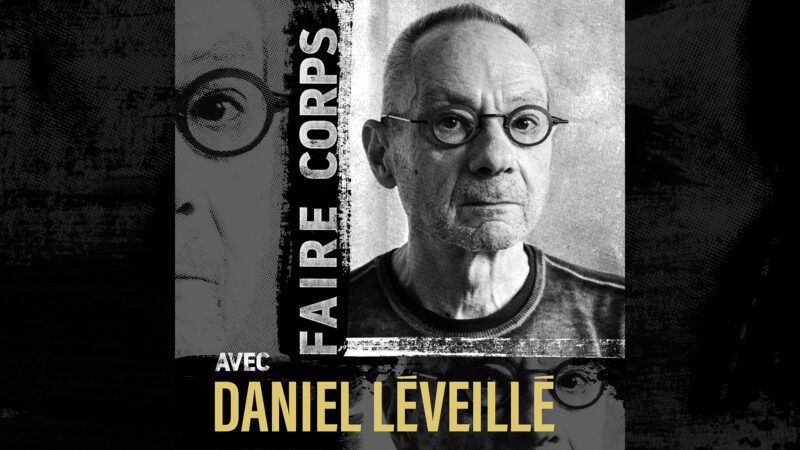Partenaires en création
Parmi toutes les œuvres de Jean-Pierre Perrault, Bertrand Chénier a créé dix pièces musicales pour lui. Entretien avec le compositeur par Guylaine Massoutre.
Comment es-tu arrivé à la danse ?
Presque par accident. Je suis devenu compositeur dans les années 80, quand la danse était en pleine effervescence. J’avais fait la musique d’un spectacle de chansons underground, et un ami m’a mis en contact avec Sylvain Émard. J’ai composé des musiques chorégraphiques pour Sylvain, au début des années 90. Puis Jean-Pierre m’a entendu et m’a invité. J’étais très occupé, on était fin juillet 1993, sa chorégraphie La Vita était programmée pour octobre. À ce moment-là, on travaillait avec des rubans; technologiquement, c’était exigeant : on s’y est mis très vite.
Quand tu as commencé à composer pour la danse, c’était au piano?
Non, j’avais déjà mon studio. J’ai toujours travaillé avec un clavier, au synthétiseur. J’enregistrais avec des bandes multipistes. Jean-Pierre n’a jamais voulu de musique live en scène ; il trouvait que cela occupait trop l’œil.
Était-ce une musique plutôt environnementale? D’accompagnement de la danse ?
Ça a été un rendez-vous avec la danse. Je suis compositeur depuis ma jeune vingtaine, je n’ai pas attendu les commandes. Quand Jean-Pierre est venu me chercher, j’ai ouvert grand les yeux sur son travail qui m’a tout de suite fasciné. C’est une rencontre entre un créateur aguerri et un jeune créateur. Je me suis servi de mon langage tout de suite, en fouillant dans mes archives.
Venons-en à La Vita. Quelle a été ta première impression ?
Excellente! Nos relations ont été fluides dès le début. Jean-Pierre a mis ma composition à jouer et, moi, je venais de voir Adieux, que j’avais beaucoup aimé. Il m’invite au restaurant pour faire plus ample connaissance, on parle d’esthétique et, le lendemain, on commence.
Voici une anecdote, qui date de ma première rencontre avec Jean-Pierre dans son édifice. Il venait d’acheter l’église et m’y donne rendez-vous. Il est assis, seul, sur l’autel, avec sa scénographie autour de lui ; j’ai pensé à De Chirico, à cause des grands panneaux de bois. Puis, ma toute dernière rencontre avec lui, ce sont ses funérailles. Après la cérémonie, je suis resté seul devant l’urne, à l’endroit exact où je me tenais dix ans plus tôt.
Tu entres dans un studio, les danseurs sont là. Que se passe-t-il ensuite?
Jean-Pierre entame les répétitions, j’assiste au travail sans musique et je me rends à mon studio. À partir de mes impressions, je compose très rapidement.
Je connaissais ses compositeurs, comme Michel Gonneville, que je respecte, mais nous n’avions pas la même esthétique. Je connaissais peu Jean-Pierre : je partais donc de l’impact de sa chorégraphie et je composais par intuition. On sortait les choses sans réflexion et on voyait si c’était bon. J’aimais cela avec lui.
Que regardais-tu dans ses chorégraphies ?
La masse des danseurs et danseuses, leur lyrisme. Jean-Pierre était un maître du contrepoint des corps. Cela me faisait penser à Bach. Je composais avec cette structure en tête.
T’appuyais-tu sur le rythme ou sur la couleur émotionnelle ?
Sur l’émotion. J’avais ressenti les six couples de La Vita et leurs relations très lyriques. Aussi, j’ai cherché tout de suite l’exacerbation, pour tester mes limites par une musique très violente et des silences. J’aime les silences. Quatre ou cinq secondes de silence, en composition, c’est long. Avec Jean-Pierre, on pouvait les faire durer une minute! La danse élargit le silence. C’était de toute beauté.
Perreault a parfois cosigné la musique de ses pièces. Était-il musicien ?
Avec l’ouverture de La Vita, j’avais senti Jean-Pierre ému. Il m’a dit : « Mets-la sur pause » puis « Repars-la ». Tout s’est enchaîné de cette première expérience. C’est une rencontre artistique : il m’a dit que je l’amenais ailleurs ; c’était vrai pour moi aussi. Je jouissais de partager l’aspect sonore de sa danse. Ses percussions avec des humains faisaient d’eux des musiciens avec lesquels je composais.
La relation d’œuvre à œuvre crée une harmonie. Comment vous êtes-vous ajustés ?
Jean-Pierre avait un langage chorégraphique précis et une conception globale de ses pièces. Sa gestuelle comportait une musique. Créer pour une telle œuvre établie demandait d’entrer par une petite porte, ensuite j’ai eu une grande liberté.
Lorsqu’il m’a demandé de l’intensité, j’ai travaillé avec des saxophonistes, et je lui ai fait entendre ce que cela signifiait pour moi. Au début de La Vita, je me suis dit « ils vont courir partout ». Mais Jean-Pierre écoute, il se lève, place les interprètes, revient s’asseoir, ils dansent et il ne reste plus que Ken Roy et AnneBruce Falconer, en équilibre sur la pointe des pieds, plus rien ne bouge au summum de l’intensité musicale : l’effet est très fort et nous arrache de l’émotion. C’était cela, le contrepoint.
Au cinéma, il y a des cues à respecter. En danse, c’est continu. Une bonne musique en danse s’auto-suffit, on peut l’écouter seule. Danse et musique communiquent. Cette collaboration a duré jusqu’à la fin de sa vie.
Que gardes-tu en mémoire de L’Instinct (1994), une installation au Musée d’Art contemporain, puis du duo, Les Ombres dans la tête (1996) et de Eironos (1996), une pièce pour dix-huit interprètes.
Ma musique apportait une dimension lyrique qui était nouvelle dans son langage chorégraphique. Ma matière était également plus brute, il l’avait écrit dans le programme. Pour L’Instinct, j’avais composé quatre heures de paysage sonore, rien de live encore. Pour Les Ombres dans la tête, j’étais au piano, à la demande de Marc Bovin. Ensuite, Jean-Pierre est parti pour l’Australie en tournée ; je n’ai pas pu le suivre : on s‘est envoyé des cassettes à l’autre bout du monde! On confrontait la danse et la musique, je me souviens combien c’était intense, durant l’été 1995, pour Eironos.
Vous preniez combien de temps pour chaque pièce ?
Environ trois mois, comme les interprètes. Il avait créé l’espace auparavant, puis il amenait ses personnages, sans script, par la sensation ; sans mots, il les déplaçait. Dans ses classes d’échauffement, il essayait des duos, des trios, qui étaient l’embryon d’une création. J’ai créé sur ces essais. Le plus souvent, je proposais une composition que je savais faite pour Perreault.
J’ai eu une complice, Ginelle Chagnon, qui connaissait la matière, parfois mieux que Jean-Pierre lui-même : elle se souvenait de tout, avec une vision précise de la chorégraphie. Elle suggérait des concordances. Quant à Jean-Pierre, il préférait « salir » sa création : il n’aimait pas les danseurs trop parfaits.
Les Années de Pèlerinage (1997) est une pièce intimiste, pour trois couples différents les uns des autres. Quelle était l’ambiance?
Le casting était exceptionnel! Techniquement, ils ne se ressemblaient pas. Cette pièce constitue notre maturité, à Jean-Pierre et à moi. Nous étions au Musée d’Art Contemporain et il disparaissait durant les répétitions : il avait appris qu’il était malade, mais nous l’ignorions. Dix jours avant la première, seulement le quart de sa chorégraphie était faite. Ce fut pourtant une de ses plus belles pièces.
On sentait la nostalgie et la mélancolie dans ses chorégraphies. E. M.F. (1999) et L’Exil-L’Oubli (1999) portent sur la mémoire. Étais-tu inspiré par ce fil conducteur ?
C’était sa signature. J’ai senti qu’on était issu du même Québec. Mêmes structures familiales, mêmes enjeux culturels. Mes frères aînés ont le même âge que lui. Ce Québec profond, ce territoire a donné le fond mélancolique de ma musique. Je suis touché par une musique de racines et de paradis perdu.
J’ai étudié à l’Université de Montréal avec Serge Garant, entre autres, mais je n’en suis pas resté à ma formation académique. Claude Vivier, mort quand j’avais 23 ans [en 1983], était pour moi une grande figure inspirante. Dans Lonely Child (1980), on sent la petite fille seule au coin de Ste-Catherine. Il m’influence encore. Jean-Pierre a travaillé avec Claude Vivier [dans Nanti Malam, 1977].
Dès la genèse de ma formation en musique, à 16 ans, la découverte du Sacre du printemps de Stravinski est une révélation. Un monde s’ouvrait à moi. On a tous eu, nous les compositeurs, le désir de créer notre Sacre du printemps.
J’ai été aussi un grand consommateur de musique industrielle, punk. Je suis issu de la décennie no future, j’écoutais beaucoup [le groupe allemand bruitiste] Einstürzende Neubauten, [le groupe rock britannique] The Cure, [le groupe rock anglais post punk] Joy Division, des bands underground qui se sont mêlés à mon écriture.
Des peintres, comme Riopelle dans l’Hommage à Rosa Luxembourg, m’ont aussi influencé. Quelque chose d’un peu disparu du Québec. L’effervescence du milieu de la danse, qui comptait les grandes pièces d’Édouard Lock, était aussi très stimulante. Ma rencontre avec Jean-Pierre fut certainement une occasion exceptionnelle d’exploration, d’ouverture et de pur plaisir de créer.