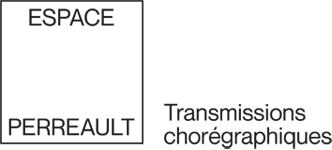Daniel Diaz, danseur de Mozongi en 2024
Je suis entré dans Mozongi sans savoir où j’allais. Cette pièce représente un défi, pas seulement du côté technique, mais surtout d’un point de vue personnel. Cette oeuvre me permet de me connaître davantage, même si ce n’est jamais définitif. En effet, si je la dansais cinquante fois, ça serait toujours nouveau.
Venant de la Colombie, je prends depuis deux ans des cours à Nyata Nyata pour comprendre davantage une partie spécifique des traditions colombiennes qui concerne les danses afro-colombiennes. J’ai commencé avec le cours de RYPADA, puis avec le répertoire haïtien, pour finalement suivre la classe avancée de Zab. En tant qu’enseignant de formation, je suis autodidacte. Étant également musicien, j’intègre rapidement le rythme dans mon corps. Je me pratique souvent sur des musiques afro-colombiennes. J’ai notamment tendance à chanter beaucoup. Dans mes cours, j’utilise d’ailleurs depuis longtemps les onomatopées comme stratégie d’apprentissage.
Nyata Nyata me permet de rencontrer d’autres façons de travailler. Il ne s’agit pas d’un enseignement anatomique. La façon de travailler de Zab procède davantage d’une recherche individuelle. C’est très global comme transmission et cela prend du temps d’intégrer un mouvement que quelqu’un a acquis dans son corps grâce à ses expériences personnelles. Il nous faut donc l’interpréter à partir de nos expériences respectives. J’ai encore de la misère à comprendre le double appui et comment placer le pied au bon moment avec le poids. Pour de jeunes danseur·euses, trouver une bonne balance au niveau des appuis demeure difficile. Ces difficultés, qui peuvent engendrer des répercussions physiques sur le corps, font partie de l’apprentissage.
Le thème 2 représente pour moi la partie la plus intéressante de Mozongi parce que, rythmiquement parlant, elle résonne dans mon corps : les avant-bras vibrent sur la même rythmique pendant un long moment. Ça a l’air facile, mais après avoir discuté avec les autres interprètes, je réalise que ce rythme n’est pas évident pour tout le monde : il faut le comprendre à l’intérieur même du corps et pas simplement avec les pieds. Bien qu’il y ait des variations infinies dans cette partie, le rythme du corps se maintient.
Plus encore que danser, j’aime penser. J’ai ma propre philosophie et mes valeurs, que je partage à travers mes actions et ma manière d’interagir avec les autres, mais je ne prends rien comme vérité absolue. Me sentir challengé face à mes propres idées me permet de voir les choses autrement. Répéter juste pour le mouvement ne me suffirait pas. J’ai envie d’un apprentissage continu. Ne pas tout savoir est l’essence même de l’innovation et de la création. Zab parle beaucoup du souffle. Qu’est-ce que ça veut dire avoir du souffle ? Peut-on avoir un souffle à l’extérieur et que peut-on apporter de l’extérieur vers l’intérieur ? À Nyata Nyata, le leadership qu’amènent de nouvelles personnes offre une pérennité à l’organisation.
Mozongi m’a permis de revoir ma façon de danser. En Colombie, on danse beaucoup de rythmes variés. Puisque c’est un pays multiculturel, la question du métissage y est très différente de celle du Canada, qui s’axe davantage sur la séparation. La Colombie n’a pas du tout la même histoire. Dépendamment de la région, les musiques, les traditions, les coutumes, les façons de parler et de danser sont complètement différentes. Apprendre des autres me permet de tisser des liens entre mes trois origines : du côté autochtone, je dois encore faire beaucoup de recherches ; du côté africain, Nyata Nyata me permet d’aller plus loin; tandis que le côté espagnol est un pan qui me manque. Ça va me prendre encore des années d’apprentissage continu.

Daniel Diaz, Jeanne Maugenest. Photo : Carson Asmundson, 2024