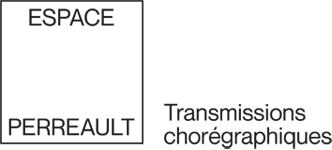Claudine Malard, danseuse de Mozongi en 2001 et en 2002
Mozongi est arrivé à un moment propice dans mon parcours. J’étais alors à la recherche d’un·e mentor·e. En France, j’avais pratiqué les danses africaines d’inspiration traditionnelle avec des professeur·es aux origines diverses et j’avais également commencé la danse afro-contemporaine auprès de différent·es chorégraphes : Norma Claire (créole guyanaise), Georges Momboye (ivoirien) et Carole Seveno (franco-camerounaise). Cette dernière – qui exerce désormais dans le champ de l’art-thérapie – m’a particulièrement séduite avec sa gestuelle très ancrée mais, en même temps, aérienne dans ses mouvements de bras à la malienne. En arrivant au Québec en 1995, j’ai donc essayé tous les cours de danse africaine et afro-descendante. Consciente de mon métissage lié à mes racines africaines, je cherchais à conserver le côté traditionnel tout en m’ouvrant à l’exploration et à la création.
Cette quête m’a conduite à Nyata Nyata. Je suis allée voir le solo Incantation au Gesù, ainsi que la première mouture de Mozongi au Centre Saidye-Bronfman – devenu aujourd’hui le Centre Segal. Je me souviens parfaitement m’être dit que ce travail m’intéressait. Entre-temps, j’ai eu un bébé, et, en rentrant de mes vacances dans ma famille à la Réunion, j’ai auditionné pour Mozongi en septembre 2000. Mozongi remonte donc à plus de vingt ans pour moi !
Ce qui me revient spontanément en mémoire, c’est la traduction du titre en français par « ceux qui reviennent », que je trouve particulièrement éloquente et très tangible dans la gestuelle de la pièce. Cette pièce fait appel aux ancêtres, à notre passé ancestral, à toutes les personnes qui ont permis notre existence. J’étais alors à la recherche de mes racines, et le fait d’arriver vers Mozongi – ou que Mozongi arrive vers moi –, juste après la naissance de ma fille, représentait une belle synchronicité. C’est une partie de moi que je lui ai transmise en héritage et c’est également à travers elle que mes ancêtres reviennent. Je me souviens de la « remontée des saumons », qui ouvrait la pièce comme une remontée vers nos origines. Je pratique d’ailleurs toujours un réchauffement de danse qui commence au sol par un balancement similaire.
Un autre passage m’a particulièrement marquée : quand nous sommes au sol et que nous nous balançons d’une hanche à l’autre avant de nous arrêter dans une position d’équilibre avec les mains face à nous. Nous sommes alors dans un balancement entre deux mondes. Le corps quitte le sol tout en s’y arrimant. Cette ambivalence est typique de cette pièce qui nous demande à la fois de travailler l’impulsion et de nous ramasser. Ce balancement produit un bien-être particulier, car je suis comme un oiseau qui a besoin d’atterrir.
Mon côté aérien a pu me poser des problèmes – encore aujourd’hui – parce que j’ai besoin de revenir au sol. J’avais donc du mal avec le concept de poids : même si je comprenais ce que Zab désirait – comment rester au sol tout en demeurant articulée ? La puissance de cet ancrage m’a attirée et, bien qu’il a été difficile à acquérir, j’ai pu sentir la liberté qu’il procure au niveau du corps. En effet, une fois ancré, notre corps demeure connecté au sol, même quand on se met à voler, comme si nos mouvements se projetaient d’une manière décuplée.
Ma bête noire, c’était l’espace. Comme je viens du monde traditionnel, où on piétine beaucoup, le défi consistait pour moi à traverser l’espace sans briser la fluidité et la souplesse du mouvement. En fait, il suffit de laisser les lignes du corps s’exprimer. C’était difficile, mais j’ai trouvé ça extrêmement puissant. La rythmique du thème 1 m’a nourrie dans ce sens parce qu’elle engage le poids d’une manière constante. Je me rappelle encore marteler le sol avec le buste incliné, marcher tout en maintenant cette position et marquer des arrêts avec les poings. Étonnamment, ce buste incliné et le balancement des bras représentaient pour moi une posture assez naturelle. J’avais le sentiment de partir à la rencontre de tous ceux et celles qu’on appelait. Avec mes bras, je me protégeais et me battais en même temps contre ces forces qu’on réveillait.
J’ai eu l’occasion de revoir Mozongi un été lors d’une représentation en extérieur [à Dorval en 2016] et j’avais envie de grimper sur scène tant je me souvenais de la chorégraphie ! C’était comme un réveil instantané ! En particulier ce mouvement [du thème 2] qu’on appelait « Mozongi/Zombies », avec les pieds ouverts, les genoux fléchis, les bras très « Zab » avec les coudes cassés, que je reprends encore parfois dans mon enseignement car il me revient naturellement sur certains rythmes. J’aime beaucoup ces articulations fléchies qu’on retrouve souvent dans l’iconographie africaine.
L’apprentissage de la figure modèle demeure, même si tu n’en maîtrises pas tous les éléments. J’adorais cette façon que Zab a de tisser des liens entre le mouvement et l’histoire. Ce bagage théorique me paraît essentiel. Il ne s’agit pas juste du mouvement pour le mouvement. C’est de cette façon que je désire enseigner. L’ancrage de Mozongi demeure dans ma pratique, j’y pense tout le temps. L’ancrage, la dynamique et le souffle intérieur sont des éléments que j’essaie de transmettre à travers mon enseignement afin d’offrir une autre façon d’appréhender la danse.