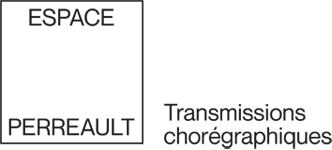Zab Maboungou
« On serait tenté de croire que des musiques fondées sur la réitération régulière de figures calibrées dans le temps sont facilement assimilables pour une oreille non avertie. Il n’en est rien : en effet, le repérage perceptuel s’y avère extrêmement difficile. Cette difficulté tient au trait saillant qui singularise ces musiques, à savoir l’ambiguïté qui s’instaure entre la régularité de la métrique et les événements rythmiques qui s’y superposent, ces derniers étant le plus souvent – et alors de façon systématique – en conflit avec cette régularité2Susanne Fürniss, « Rigueur et liberté : la polyphonie vocale des pygmées Aka (Centrafrique) », dans Christian Meyer (dir.), Polyphonies de tradition orale. Histoire et traditions vivantes, Paris, Créaphis, 1993, p. 101-131. . »
J’ai voulu m’aider de cette citation pour tenter de rendre compte de ce que peut mettre en oeuvre une forme de danse comme celle que je pratique, lorsque celle-ci est issue d’un contexte musicoculturel [ce terme précède la notion de « rythmiculture » que je formulerai vingt ans plus tard, NDA] comme celui qui est discuté ci-dessus, et dont les sources, justement, proviennent d’Afrique centrale. Car il va sans dire que ce qui est exposé ici, et qui s’applique à la musique, s’applique aussi à la danse.
Toute ma recherche sur le mouvement est inextricablement liée à une exploration des rythmes. Non pas le rythme « objectif », le rythme en « général », mais les rythmes particuliers et vivants… Je n’ai d’autre ambition que celle de m’immiscer dans ce qui, au détour, me prendra de court : le rythme. Dans cette optique, tout mouvement appelle son rythme, tout rythme appelle son mouvement.
Mes danses n’ont pas d’histoire, mais elles tentent de tisser une étoffe. Reverdanse travaillait les textures (d’où la variété instrumentale et les divers tableaux qui s’y déployaient), Incantation travaille la trame (à deux tambours, essentiellement). Dans chaque cas, le mouvement exprime des états (ici, états du corps et états d’esprit, bien entendu, se confondent) qui s’autosuffisent et qui sont développés comme tel. Les émotions sont autant d’états-mouvements, efficaces en tant que tels, et non des supports de la personnalité ou des supports du drame. L’individu dansant n’a de force que dans la mesure de sa dépersonnalisation (un état de choses qui, je crois, rend mal à l’aise et déçoit, particulièrement dans Incantation, où le mouvement qui s’y déploie n’a rien à voir avec des « états d’âme » se transmettant sur le plan de la communication sociale, mais traduit plutôt des états tout court, possédant une dynamique interne propre). La musique – et, de mon point de vue, toute la composition rythmique est musique – y construit la danse et la danse y construit la musique. C’est dans cette interdépendance constante (y compris lorsque, seuls sur scène, les musiciens « continuent la danse », ou même lorsque ne se joue aucune musique) que se révèlent la structure et, donc, la progression de mes pièces.
La progression, en effet, repose sur la capacité des éléments de la danse (corps-voix-instrumentation-lumière) de s’interpeller entre eux de façon autonome. Elle est une manière de parvenir à une certaine cohésion qui n’est jamais définitive – un aspect que traduisent également les arrangements musicaux – et qui est une manière d’entrer dans le rythme, au sens fort du terme. Tout effort chorégraphique n’est ainsi, selon moi, qu’une façon nouvelle et inédite d’entrer dans le rythme. Il n’y a rien d’autre, d’où que l’on parte.
Je conçois mes chorégraphies comme des dispositifs que j’appelle des « poétiques », des sortes de petits univers rythmiques, que « j’habille » (c’est la « mise en scène ») afin qu’ils puissent s’incarner. Un peu comme le masque africain dont toute la puissance et le mystère résident dans son caractère abstrait et vivant à la fois (le masque, dans son rapport à la danse, est aussi un aspect peu compris de la danse africaine, et de l’art africain en général).
Ma chorégraphie, Les Revenants (Mozongi), poursuit dans le même esprit ce « travail sur la trame » à travers une poétique du temps, tout en étant une « physique » du temps : les revenants sont des êtres du/de temps qui, en s’ancrant dans le sol, s’ancrent dans le temps, emplissant nos vies du souffle qui les anime.
Avec Les Revenants, j’opère en quelque sorte un « retour » à la chorégraphie de groupe (mais, bien que je ne crois pas que le solo soit anti-chorégraphique, je tiens à préciser qu’aucune de mes chorégraphies ne sont des « solos » à strictement parler). Pourtant, cette étape s’impose d’elle-même et ajoute une autre dimension à l’entreprise, tout en la simplifiant, d’ailleurs, à d’autres égards : « l’occupation » de l’espace, par exemple, est une illusion, une étrangeté, que mes danses et la manière que j’ai, entre autres, de les « éclairer » tentent de conjurer, puisque les ombres, en effet, sont habitées, que l’absence (de corps) éclaire et que la danse ne se compte pas au nombre de corps qui s’agitent. L’éclairage et le son demeurent à cet égard des préoccupations majeures.
Je crois, en fin de compte, que la danse fabrique des présences dans le temps, toutes éphémères, dont la force, équivalente à leur grâce, est de disparaître. Ce qui me démange, me dérange et m’inspire tient tout entier là, pour un bout de temps encore.
et que le souffle suspend le temps
Comment savoir si,
dans le moment qui vient et
qui étreint le moment qui passe,
Il restera la trace
de ces êtres et de ces choses
qui déjà
ne sont plus ce qu’ils étaient
Ah ! n’ayons nulle crainte !
car complices du silence
nous suspendrons le temps3Texte du prélude au solo Reverdanse (1991).
Ebetaka
Ndengue nini
To ko yeba
E te
Ntango oyo
Tozali
Ezali
Ntango oyo
Tozalaka
He he he
Ko banga te
O ko kufa te4Texte original en lingala. Récité par Zab Maboungou dans l’extrait audio
Notes
- 1Texte inédit rédigé en décembre 1997.
- 2Susanne Fürniss, « Rigueur et liberté : la polyphonie vocale des pygmées Aka (Centrafrique) », dans Christian Meyer (dir.), Polyphonies de tradition orale. Histoire et traditions vivantes, Paris, Créaphis, 1993, p. 101-131.
- 3Texte du prélude au solo Reverdanse (1991).
- 4Texte original en lingala. Récité par Zab Maboungou dans l’extrait audio