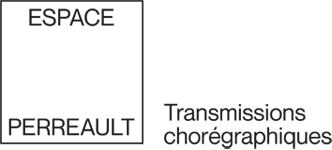Maryse Jeanneau, répétitrice de Mozongi à la création en 1997 et en 2001
J’ai toujours accompagné Zab de très près : chaque fois qu’elle répétait, j’étais là ; pendant ses spectacles, j’étais toujours là, en arrière ou sur le côté. Je l’ai vue répéter pendant des heures et je me suis beaucoup nourrie en l’observant, en décortiquant son travail. On dansait toujours côte à côte quand elle donnait ses classes, j’ai donc été imprégnée de son énergie. Je captais tout. Pour Mozongi, elle m’a initié aux mouvements par parcelles pour en comprendre les ressorts, les impulsions, les inclinaisons du buste, les détentes et comment y déposer le souffle. J’en ai bavé au début, parce que je n’avais pas l’habitude de travailler à ce niveau-là. J’ai tellement travaillé ses constructions rythmiques qu’elles sont ancrées en moi à jamais malgré mon mal de dos actuel !
Mozongi est une pièce qui m’a énormément marquée. Elle est empreinte d’une force et d’une sinuosité singulières. Notamment le début, avec la séquence allongée au sol, dans laquelle on développe une rythmique assise à l’intérieur de soi. Il y a quelque chose de très sinueux dans la manière de progresser au sol en gigotant, puis de s’étaler, de se remonter et de retomber au sol. Mozongi implique des allers-retours continuels : on se retire du sol pour y revenir constamment !
Mozongi, c’est la force, la puissance et la volupté. Les séquences au sol, qui sont assises et très centrées, exigent un gros travail pour la majorité des interprètes. Pas tant dans la robustesse, mais plutôt à travers une force doublée d’une détente incroyable ! Comprendre le point d’impulsion, ainsi que le retour et l’assise au sol, implique de ramasser le corps et de l’étirer… Les suspensions sont à ce titre extraordinaires ! Nous sommes en élévation tout en piétinant énormément. Même quand on se sent à l’étroit dans une posture, les jambes sont déployées et le corps est déposé. On apprend beaucoup à l’intérieur de cette chorégraphie, dont les mouvements demeurent extrêmement puissants.
La partition de Mozongi est construite comme un momentum qui conduit aux ondulations finales – que Zab désigne comme le mouvement « Mozongi ». Il s’agit d’une incandescence qui monte et, tout à coup, se suspend. Zab a l’art de travailler la rythmique pour que, tranquillement, quelque chose se manifeste. C’est tout un paysage que l’on traverse ; on devient une sculpture qui se meut. J’ai toujours été fascinée par l’art africain, que je retrouve concentré dans cette pièce. Au niveau de l’imaginaire, Mozongi m’évoque les masques, les couleurs, l’expression et la vitalité.
Pour ses créations, Zab alterne généralement entre un solo et une pièce de groupe, comme un jeu de questions et de réponses. Un fil conducteur relie chaque pièce. Certains éléments travaillés dans une pièce reviennent parfois sous une autre perspective. Zab est structurée et concise. Elle travaille énormément sa gestuelle : avant de présenter les mouvements aux danseur·euses, elle compose d’abord en solo.
Moi qui collaborais avec elle, j’ai dû trouver le fil du souffle dans mon propre corps avant de le transmettre en tant que répétitrice. Zab transmet ses rythmiques à travers des chants onomatopéiques. Quand on les chante, ils prennent littéralement vie. C’est fou ! On comprend alors le mouvement en intégrant le souffle qui est déployé par la rythmique.
Je pourrais danser la pièce à nouveau, tant les rythmiques de chaque partie sont gravées en moi. Je les danserais sans doute même mieux aujourd’hui parce qu’elles ont grandi à l’intérieur de moi ! C’est incroyable ce que provoquent les rythmes ! Les chanter nous permet de les ressentir ! Quand tu chantes, le rythme devient vivant, il est puissant. Zab ne t’apprend pas simplement à danser, mais à devenir ton·ta propre musicien·ne en comprenant la rythmique que tu déploies. Tu n’as pas besoin du tambour. Toutes ses pièces sont construites ainsi : avant que la musique intervienne, les danseur·euses doivent connaître la partition. Ce n’est pas du « 1, 2, 3, 4 », la partition est continuellement ponctuée de souffles : un souffle en attrape un autre. Nous restons imprégné·es de ces rythmes : même si on en a souffert, ils sont si généreux et si florissants qu’ils continuent de nous interpeller et de gronder en nous.
Chaque partie nous plonge dans un état particulier et chaque posture invoque une multitude de choses. Quand tu gigotes au sol, tu deviens quelque chose qui sillonne ! C’est méditatif, tu es en préparation. Après ça, tu t’élèves et quelque chose d’autre survient. C’est très poétique. Chaque séquence en appelle une autre et elles s’emboîtent. Dans la séquence des criquets [ou des canards], le chant Nta ka ! Nti ka ta ! fournit ton appui. Tous ces souffles, on les intègre au sol, on les ramasse, puis on les construit pour entrer dans un tout autre univers. L’interprète se transforme quand les mouvements s’installent dans des motifs sériels.
Cette pièce n’est pas linéaire, elle est multidirectionnelle. Le mouvement n’est jamais carré ! Les torsions viennent nous challenger. Il y a dans l’art africain des asymétries incroyables, en écho aux éléments de la nature et en lien avec la façon dont on se bat ou se ramasse dans la vie. Certain·es interprètes ont de la difficulté dans le ramassage ou dans le sinueux. Zab trouve énormément de clés pour transmettre ces postures et activer le mouvement dans plusieurs directions. Elle ajuste ses mouvements et réaménage la pièce constamment. Elle travaille à partir du corps qui est là. Elle utilise sa manière de bouger. Elle propose de multiples façons de l’aborder et de l’emmener.
En Afrique, le souffle, c’est la vie. Zab en a fait une méthode qui permet de libérer le corps et de l’asseoir. Par ce travail du souffle, Zab a instauré une vie intime en moi. Elle m’a assise dans mon propre corps et m’a aérée. Son travail a énormément nourri la femme que je suis devenue. Il m’a permis de goûter à ce plaisir que je ressens encore malgré mes blessures. Je recherchais ce travail du souffle même en marchant. C’est si bon de sentir cette capacité s’activer dans mon corps, comme quelque chose qui coule.

Zab Maboungou, Maryse Jeanneau.
Photo : Thiery Arnold, Nyata Nyata, 1998