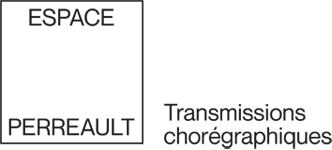Raphaëlle Perreault, danseuse de Mozongi de 2014 à 2015
Mozongi est sans aucun doute la pièce qui m’a fait le plus cheminer à la fois humainement et physiquement. Je me suis peu reconnue en tant qu’interprète dans mon parcours académique en danse. J’étais très ancrée au sol. En revanche, je connectais davantage en breakdance où l’accent était mis sur la corrélation musicale avec l’endurance musculaire. Je ne connaissais pas Zab comme chorégraphe. Je me cherchais une occasion de travailler et j’ai vu passer une audition pour un rôle masculin. Même si je n’ai pas été retenue, j’ai trippé sur la connexion à la musique, notamment la percussion.
La percussion et la représentation d’un corps plus proche de mes valeurs m’ont conduite vers Mozongi. Même sans avoir de racines africaines, je me sentais reliée, bien au-delà de ma généalogie, à une base commune, à la fois énergétique et intemporelle. D’ailleurs, je ne me souviens ni des visages ni des noms, mais je me souviens des corps et des présences. Pourquoi mon corps répond si bien, et physiquement dans l’effort, et musicalement dans le rythme ? Je serais capable de redanser cette pièce sans la vidéo, juste en écoutant Elli et Adama jouer !
Au-delà de l’occasion de danser et d’être rémunérée, Mozongi représentait avant tout pour moi un moteur. C’est la pièce la plus exigeante que j’aie dansée. Elle m’a prouvée que j’étais endurante, et, qu’à force de répétition, de rigueur et de concentration, j’étais capable d’atteindre ce potentiel. J’essaie actuellement de retrouver ce levier, tant cette exigence physique produit de l’énergie. Ça prend du temps et des efforts, mais quand tu dépasses un certain stade, un monde s’ouvre à soi, à la découverte de son potentiel. Quand on court, on accède à cette même sensation d’introspection et de déconnexion. Il me faudrait retrouver un Mozongi aujourd’hui dans ma vie comme moteur de création.
La chorégraphie était écrite et tout un entraînement accompagnait l’apprentissage de l’oeuvre. Mes conditions de travail n’avaient jamais été aussi bonnes, autant considérant le taux horaire de l’époque, qu’en raison d’heures de répétition garanties. Ce cadre de travail sécurisant nous incitait à jouer le jeu, même si je ne m’attendais pas à devoir répéter de vingt et une heures à minuit ! Néanmoins, répéter à cet horaire, avec la fatigue et en décalage avec le monde, s’est avéré une expérience audacieuse dont je conserve un souvenir positivement très marquant.
Certaines séquences étaient particulièrement inconfortables, mais le corps finit par s’ajuster avec la pratique. Par exemple, au début de la pièce, quand on est assis·e et qu’on chante Ntin ka Ntin ka Ta !, mes fléchisseurs sortaient de mes hanches et j’avais hâte que le mouvement se termine ! Cependant, plus j’assumais mon chant intérieur, mieux j’étais capable de le canaliser. Cette séquence s’est donc transformée avec le temps. Si je me remettais à terre maintenant, je serais capable de la refaire. Je sais désormais par où passer pour me sentir bien dans cette position.
Zab nous conduit dans un cheminement profond qui, bien au-delà de l’interprétation, touche à la question de la présence. J’aurais pu me faire des podcasts avec les paraboles de Zab en répétition ! C’est un contenu d’une extrême richesse : il s’agit de comprendre le chemin du mouvement dans notre corps, dans l’expérience du moment présent. Cela nécessite d’être consciente d’où mon corps se situe dans l’espace. Le thème 2 m’a ainsi permis de comprendre le centre 2. C’était très exigeant au début parce que tu peux le prendre dans le dos. Mais quand je l’ai compris, j’ai pu libérer mes hanches et me reposer. Je me souviens d’une répétition, un soir, où nous n’avons pas arrêté pendant quarante-cinq minutes ! C’était particulièrement éprouvant, la musique roulait en continu et nous étions dans l’expérience d’une répétition transcendantale de ce motif ! Dans cette séquence en particulier, nous réalisions des variations individuelles. Au début, j’y parvenais une fois sur huit !
J’adorais sauter à la fin de la pièce ! C’était magique de sentir l’énergie du groupe ! Mais il fallait traverser tout ce qui précédait pour en arriver là, avec la fatigue et le relâchement. Le fait d’être ensemble dans un objectif commun constitue pour moi la clé de mon engagement à atteindre mon plein potentiel. Cette relation à l’autre devient un investissement pour créer de l’énergie et atteindre des objectifs qui n’ont finalement rien à voir avec l’entraînement. J’adorais également danser en duo avec Mithra [Rabel]. Il s’agit d’une petite partie transitoire, dans laquelle nous terminions à deux un tableau, avant d’appeler les autres à nous rejoindre. Comme dans les sauts, c’est un passage stimulant au niveau de la complicité.
Enceinte, j’ai pu toucher à une autre dimension de la pièce, dans laquelle la maternité faisait partie de l’expérience de Mozongi. Zab a alors partagé avec moi le vécu de sa propre maternité, ce qui m’a permis plus tard de mieux traverser certains moments difficiles de la parentalité. Humainement, j’ai besoin de mon espace et de mon poids. Zab disait d’ailleurs : « Tu n’as pas le poids que tu as déjà eu, ni celui que tu aimerais avoir, accepte ton poids d’aujourd’hui. Assume ce poids dans ton pas sinon je ne te vois pas. » Ces paroles m’accompagnent encore parce que j’ai toujours cinq livres de trop que j’aimerais perdre, mais Mozongi me rappelle le poids des choses. Assumer le poids de la vie permet à la fois de mieux recevoir ce que le monde a à offrir, mais aussi de mieux te présenter au monde.
Cette pièce a nourri mon rapport au legs, à la maternité et au passage. Mozongi représente ma dernière expérience marquante de danse. Elle m’a amenée à créer une entreprise qui s’appelle « Les passages » et qui vise à ancrer au-delà du temps des ponts qui favorisent la relation. Pour moi, il y a quelque chose de significatif que je pourrais attribuer à Mozongi dans cette responsabilité que je souhaite laisser comme trace.

Jennifer Morse, Aboubacar Mané, Raphaëlle Perreault, Mithra Rabel, Luis Cabanzo, Karla Étienne, Gabriella Parson.
Photo : Kevin Calixte, 2014