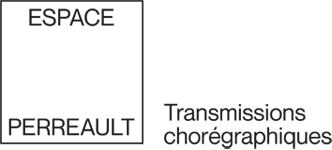Katya Montaignac

Mithra Rabel, Marie-Denise Bettez, Karla Étienne, Salomao Almirante.
Photo : Foteini Christofilopoulou, 2019
Un danseur entre en scène et marche sur le plateau. D’un pas affirmé. Presque pressé. Après un long moment, une danseuse lui emboîte le pas et circule dans l’espace. Concentrée, elle avance tranquillement et semble glisser sur le sol. Puis une autre danseuse apparaît, déterminée, dans une démarche presque nonchalante. Contrairement aux deux autres, elle laisse ses bras balancer durant sa marche. Chacun·e est focalisé·e sur sa marche, à la fois présent·e et absent·e. Concentré·e dans l’instant et absent·e aux autres. Les interprètes semblent ne pas se voir, iels ne se regardent pas. Deux autres danseuses arrivent sur scène. La première, plus en retenue, presque hésitante, tandis que la seconde, ancrée dans le sol, trace son sillon à travers le groupe. Au total, sept interprètes arpentent le plateau, chacun·e suivant son trajet propre, assumant une démarche singulière. L’ensemble crée une foule, provenant de différentes directions. Un rythme commun porte le collectif, et pourtant, chacun·e semble suivre une cadence distincte. Iels se croisent sur le plateau, tels des spectres circulant dans l’espace.
On marche dans l’espace pour ouvrir et pour introduire les corps dans l’espace. Des corps autonomes et marqués de leur personnalité propre.
La marche est le mouvement fondamental de la danse, à la fois le plus accessible à tout être humain et, paradoxalement, le plus complexe à réaliser sur scène. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Zab Maboungou a nommé sa compagnie « Nyata Nyata », qui signifie « piétine, piétine » en lingala, la langue des deux Congo : « Nyata Nyata, c’est une manière très simple de dire que l’être humain se tient debout et que c’est un être marcheur 1André Lavoie, « Chorégraphe et philosophe en mouvement perpétuel », Le Devoir,
28 mars 2015. . » L’apprentissage du RYPADA place à ce titre la marche au centre « en pratiquant continuellement [cet] acte simple et faussement difficile [afin de] reconsidérer très attentivement cet acte fondamental de locomotion 2Melissa Templeton, « Walking with the self: Zab Maboungou´s interventions against eurocentrism through contemporary african dance », Dance Research Journal, vol. 49, no 2, août 2017, p. 53. Traduction libre. ». Alors étudiante au PEFAPDA – devenue aujourd’hui interprète de Mozongi et formatrice du RYPADA –, Jeanne Maugenest relie directement la marche de Mozongi à la technique du lokéto, qui revient sans cesse sur « l’intelligence de la marche humaine » :
« Toute la finesse de la marche procède de l’amorce, qui précède le premier mouvement : la capacité à reconnaître […] “d’où on part” dans le temps et l’espace qui nous est donné. C’est toujours le bas qui rencontre le haut, et c’est le Lo [situé dans les pieds] qui assoit le corps. Le travail à partir d’un pied plein, percussif, permet de libérer le genou, le Ké, et peut ainsi se projeter dans la marche. Le To, enfin [situé au niveau des hanches], représente le “retour”. […] Dans Mozongi, les interprètes ont dû non seulement intégrer ces concepts, mais surtout les incarner pour trouver la marche du retour. Mécanique d’une sempiternelle renaissance, la marche représente cet aller vers. Elle est mouvement, déplacement, émancipation. Elle rassemble et sépare les êtres. Qu’elle soit pacifique ou révoltée, entourée ou solitaire, contrainte ou volontaire, elle est l’essence même de la quête de l’Homme 3Jeanne Maugenest, « Essai sur Mozongi », devoir rédigé dans le cadre du PEFAPDA, 2020. . »
Ce tableau de la marche, qui ouvre la pièce, est crucial pour la chorégraphe : « Tous les êtres humains sont des marcheurs. La danse et le tambour établissent et magnifient la marche humaine. » Pourtant, ce tableau inaugural a été conçu vingt ans après la création originale de l’oeuvre à l’occasion de sa recréation en 2014. Les interprètes, alors immobiles en groupe, entament l’un·e après l’autre une marche, d’abord circulaire avant de se disséminer dans l’espace :
La marche introduit des personnalités corporelles, des corps. Elle ne cherche pas à uniformiser. On place les gens dans un rythme pour faire ressortir la distinction. Et c’est une marche multidimensionnelle. Comme tout le reste par la suite. Elle établit d’emblée la multidimensionnalité, à savoir que je recule ou que j’avance, j’avance toujours. Je me projette.
Ce premier tableau ancre les interprètes dans l’espace. Il demande un travail constant qui n’est jamais acquis :
Vous préparez toute la pièce à partir de cette marche. On ne doit pas avoir l’impression que vous attendez : « Je ne suis pas en train de partir, je suis déjà là-bas ! » Marchez avec le talon en premier. Votre dos avance avec vous. Ne restez pas en arrière. Vous ne marchez pas seulement avec votre centre 2 [que Zab situe au niveau du sternum], c’est votre centre 1 [au niveau du bassin] le plus important. L’échange se fait sans arrêt au niveau des pieds. Les pieds travaillent et le reste du corps demeure au centre. Le travail du dos est essentiel.
Mozongi débute ainsi par une marche qui présente les différentes « personnalités corporelles » et non les personnes elles-mêmes. Zab tient à cette distinction : « Ce n’est pas Zab qui marche, c’est mon corps. Je me rends absente à moi-même. » Pour Funmi Adewole Elliott, dramaturge et chercheure en danse, l’action de marcher dans une classe de Zab lui a permis de « penser la danse comme une pratique transnationale et transculturelle parce que nous marchons tous différemment » : « Dès que l’on commence à marcher dans le cours de Zab, on se rend compte de la complexité de la marche. […] [S]entir comment nos pieds connectent avec le sol. Et soudain, je prends conscience de la façon dont j’utilise mon poids. Et cette marche qui est un mouvement universel […] – marcher est ce que l’humain fait – quand un enfant naît, nous voyons que la marche est une lutte
4Maboungou: Being in the World, Montréal, 2023. Réalisation : Marlene Millar et Philip Szporer. Production : Mouvement Perpétuel (48 min). . »
Cette marche peut être lente. Ce n’est pas la vitesse qui compte mais l’énergie que tu y mets pour soutenir ta présence dans l’espace.
Omniprésente dans Mozongi, la marche se décline tout au long de la pièce, de la station debout à la posture assise (marche sur les fesses) et même allongée sur le sol par le biais de rampements : « La marche ne s’interrompt jamais, [même lorsque] les interprètes gisent au sol, mais évoluent au son entêtant de ce nouveau trajet rythmique 5J. Maugenest, op. cit. . » Plus tard, dans l’oeuvre, la marche s’effectue en rythme, avec des frappés sur le sol, le buste penché en avant, à travers un motif que Zab désigne comme une « double marche ».
C’est un travail constant. Cette marche est importante, elle est cruciale. Cette marche n’est jamais acquise. J’y tiens mordicus. Toute l’oeuvre que j’annonce est dans cette marche. Tout a été dit avec cette marche.
Notes
- 1André Lavoie, « Chorégraphe et philosophe en mouvement perpétuel », Le Devoir,
28 mars 2015. - 2Melissa Templeton, « Walking with the self: Zab Maboungou´s interventions against eurocentrism through contemporary african dance », Dance Research Journal, vol. 49, no 2, août 2017, p. 53. Traduction libre.
- 3Jeanne Maugenest, « Essai sur Mozongi », devoir rédigé dans le cadre du PEFAPDA, 2020.
- 4Maboungou: Being in the World, Montréal, 2023. Réalisation : Marlene Millar et Philip Szporer. Production : Mouvement Perpétuel (48 min).
- 5J. Maugenest, op. cit.