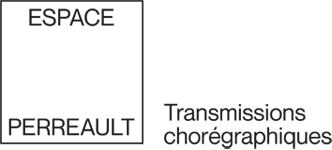Bruno Martinez, tambourinaire pour Nyata Nyata depuis 2015
En arrivant à Montréal, mon but était de gagner de l’argent pour partir étudier et travailler en Afrique pendant un an ou deux. Montréal m’a finalement ouvert une porte sur les mondes de la musique et de la danse africaine.
Mozongi a été un processus d’apprentissage à la fois confrontant et très enrichissant, car c’était un tout autre langage pour moi ! À l’époque, ma conception de la musique était très carrée puisque j’avais appris des phrases rythmiques précises avec des maîtres africains, mais avec Zab, on ne fait pas un copié/collé d’un rythme ! Non seulement ses rythmiques sont complexes, mais en plus, Zab ne compte pas les mesures ! Cela exige un travail intuitif lié à un langage profond, qui vient de loin, alors que jusque-là j’avais appris à enfermer les rythmes dans des boîtes. J’ai donc dû recommencer à zéro, ou presque !
Pendant deux ou trois mois, j’ai travaillé presque tous les jours sur cette pièce. C’était intensif parce qu’on partait bientôt en tournée. Au début, il y a eu beaucoup de résistance de ma part à comprendre et apprivoiser le langage et la façon d’aborder la création. Une chance qu’Elli [Miller-Maboungou] était là pour assurer la traduction et canaliser ce langage musical avec lequel je n’étais pas familier ! Mozongi m’a ouvert un univers qui a remis en question là où je me situais et ce que je projetais pour le futur. C’est fou parce que Mozongi – qui signifie « retour » – a justement constitué un véritable retour sur moimême qui m’a permis de retrouver ma voix. En répétant les phrases et les rythmes que j’avais appris après un an en Afrique de l’Ouest, je me suis rendu compte que je reproduisais une culture de manière superficielle. Alors qu’avec Mozongi, je l’ai abordée d’une façon plus profonde, avec le respect que cela implique, et je commence à pouvoir parler ce langage avec mes propres mots.

Elli Miller-Maboungou, Bruno Martinez. Photographe inconnu·e, 2016
Cette pièce incarne beaucoup de résilience pour moi, car elle a complètement bouleversé ma façon de percevoir la musique, la danse, la percussion et les arts en général. J’ai eu du mal à apprendre la séquence jouée avec les bâtons, qui correspond pourtant à un thème précis. Bien que carrée, cette séquence demeure, en même temps, assez ouverte. Ça a été difficile pour moi de trouver la rigueur dans cette liberté. La difficulté consistait également à jouer en même temps que mon partenaire. Le thème 2 me rejoint davantage parce qu’il s’agit d’un rythme qu’on retrouve en Afrique comme en Amérique latine. De prime abord, on pourrait croire qu’il est simple, et pourtant, je peux jouer avec cette simplicité pour revisiter la pièce.
En tant que musicien, je constitue une pièce importante du casse-tête de Mozongi. Cette oeuvre me confronte au moment présent. J’apprends chaque fois à ne rien prendre pour acquis. Même quand on joue un rythme pendant deux heures, nous devons assumer notre présence de manière constante. Chaque fois qu’on la revisite, de nouvelles choses apparaissent. Les nouveaux danseur·euses amènent une certaine fraîcheur. Moi-même, j’ai avancé dans ce langage, tout comme Elli. Mozongi aujourd’hui ne ressemble pas au Mozongi initial, il y a trente ans. C’est complètement différent. Et pourtant, il s’agit du même mouvement et du même rythme, mais abordé autrement. Tout comme la tradition, cette pièce est vivante.