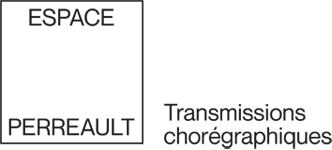Jeanne Maugenest, danseuse de Mozongi en 2024
Chaque fois que je danse Mozongi, je me sens entre deux mondes, entre le ciel et la terre. Cette pièce nous permet de devenir des intermédiaires. Ce qui importe n’est pas tant d’exprimer quelque chose que d’accomplir un effort d’authenticité. C’est un devoir. C’est un cadeau très exigeant et dont il faut être dignes. Cette pièce nous connecte à ceux qui étaient là avant nous et qui nous ont fait de la place. Je ne le vois pas comme un poids, au contraire, mais comme un challenge à vie. Ce n’est pas l’affaire de deux mois de répétitions et puis on oublie ! Quand je pense à Mozongi, je pense « force ». Quand je rentre dans Mozongi, c’est comme si ma peau s’épaississait.
Mozongi a été créée en 1997. J’avais alors six ans et mon grand-père est décédé cette année-là. C’était une personne dont j’étais très proche et qui m’a beaucoup influencée dans ma manière de questionner le monde. Pour moi, danser Mozongi est un cadeau. Un cadeau difficile qu’il faut travailler au corps en permanence, qui nous offre ce temps, ce moment présent et une manière de nous connecter à l’instant.
Je suis arrivée au Québec en 2016 pour intégrer une formation en danse contemporaine à l’UQAM. Venant des Antilles, j’ai toujours ressenti une problématique dans la manière dont on enseigne la danse aujourd’hui en Occident, notamment dans les institutions. Pendant mon parcours, il y a toujours eu des allers-retours entre ma formation et l’idée que l’on se fait du métier.
Heureusement, j’ai découvert Nyata Nyata. Je suis arrivée aux portes ouvertes en pensant que Zab était un homme ! Et j’ai vu surgir une petite dame avec une énergie et une force impressionnantes ! J’avais l’impression de retrouver une ancêtre. Il y avait déjà ce rapport à l’aînée et de respect, comme avec mon grand-père. J’ai senti quelque chose de spirituel dans ce qu’elle devait me transmettre.
Pendant ma formation au PEFAPDA, j’ai eu à analyser Mozongi avant même de la danser. Ce qui me fascine dans cette pièce, c’est la manière dont on tricote le temps. Zab n’est pas dans un travail de tableaux et de transitions. Rien n’est clair ou setté. Cela peut être déstabilisant, surtout quand on est un·e danseur·euse exécutant·e qui attend d’être guidé·e. Bien que la gestuelle soit très précise, tu as une liberté assez incroyable à l’intérieur de cette pièce. Danser Mozongi est un souhait que j’ai formulé il y a cinq ans. C’est à la fois un miracle et un cadeau ; ça devait arriver.
Tout ce travail est une question de réappropriation de mon corps. À travers la danse, je retrouve ma légitimité à porter mon corps. Mozongi m’aide à combattre certaines peurs encore paralysantes et à prendre conscience de la force qui est à l’intérieur de moi et de la manière avec laquelle je sais me battre. C’est comme si je réapprenais.
Il y a cette notion de tissage et d’interconnections. La marche du début est déjà le tableau de la fin. Chaque fois, ça s’entrecoupe. Ce n’est pas une montée en puissance, mais toute cette information avec laquelle on danse devient une langue. Je me sens connectée à tout ce qui se passe autour de moi et à tout ce qui est invisible.
Le rythme des kratikratikra, qui correspond à un moment au sol au tout début de la pièce, me ramène instinctivement à la maison : ce rythme me rappelle celui des grenouilles qui chantent dans les pays tropicaux dès que le soleil se couche. Cela correspond au moment où, nous aussi [les danseur·euses], on se couche dans la partition, mais tu vas devoir te battre avec toi-même pendant quarante minutes. Il y a un bonheur dans le fait de savoir que nous allons nous battre avec l’idée que nous nous faisons de nos propres limites et de nos capacités. On devient véritablement surhumain·es ! Ça vient nous chercher ailleurs que dans notre humanité en tant qu’êtres sociaux. Cette pièce nous réunit, non pas sur le plan de ce qu’on aimerait être tous les jours face aux autres, mais plutôt selon une essence pure. D’ailleurs, dans cette pièce, on ne peut pas mentir.